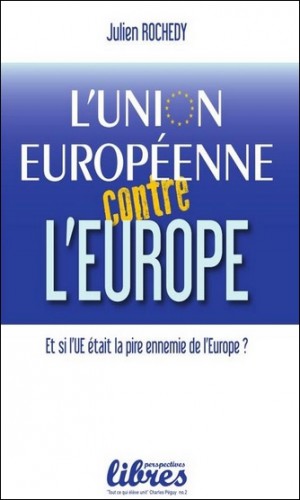Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Alain de Benoist, cueilli sur Boulevard Voltaire et consacré à la crise ukrainienne...

Crise ukrainienne : la servilité de l'Union européenne
À en croire l’actualité ukrainienne, nous voilà revenus au « bon vieux temps » de la guerre froide, époque à laquelle tout était simple : les « gentils » d’un côté, les « méchants » de l’autre. L’histoire se répète ?
L’histoire ne se répète jamais, mais il y a des constantes historiques. La tension entre la puissance de la Terre, représentée par le continent eurasiatique, et la puissance de la Mer, représentée par les États-Unis, en est une. Retour à la guerre froide ? Je dirais plutôt qu’elle n’a jamais cessé. La preuve en est que l’OTAN, qui aurait dû disparaître en même temps que le Pacte de Varsovie, s’est au contraire transformée en une machine de guerre américano-centrée à vocation planétaire. Dès la chute du mur de Berlin, elle n’a eu de cesse de s’implanter à l’Est, en violation flagrante des assurances données à Gorbatchev au moment de la réunification allemande. La crise ukrainienne s’inscrit dans ce contexte. Il s’agit, pour les Américains, d’être présents jusqu’aux frontières de la Russie – ce que celle-ci ne peut évidemment pas accepter. Vous imaginez les USA acceptant l’installation de bases russes au Mexique ?
La nouveauté, c’est que l’Europe n’a même plus l’excuse de la « menace soviétique » pour justifier son atlantisme. La façon dont l’opinion publique est systématiquement désinformée à propos de l’Ukraine atteste de l’état de servilité dans lequel l’Union européenne est tombée. Le gouvernement issu du coup d’État de la place Maïdan envoie ses bombardiers et ses blindés tirer sur les « séparatistes » russophones, la guerre civile a déjà fait 2.500 morts, et ceux-là mêmes qui accusaient hier Bachar el-Assad de « massacrer son propre peuple » applaudissent des deux mains (ou s’en foutent complètement).
Quant aux nationalistes ukrainiens, dont les objectifs n’étaient pas méprisables, leurs erreurs d’analyse ont fait d’eux les dindons de la farce. En s’engageant les armes à la main contre leurs compatriotes, ils n’ont obtenu le départ d’un oligarque pro-russe que pour l’échanger contre un oligarque encore plus corrompu, un roi du chocolat aux ordres de Washington et de l’Union européenne, qui compte sur les Occidentaux pour sauver de la faillite une Ukraine désormais retombée au niveau d’un pays du tiers monde. Ce qui revient à dire qu’ils sont tombés de Charybde en Scylla.
La vérité est qu’il n’y a pas de solution militaire à la crise ukrainienne. Et que cette crise est gravissime. Si Kiev n’accepte pas d’instaurer un système fédéral permettant à chacune des composantes du pays, à commencer par le Donbass, de bénéficier de son autonomie, la guerre civile va s’étendre et l’Ukraine se brisera en deux, sinon en trois. La Russie pourra alors moins que jamais rester inerte. Or, comme l’a dit ici même Dominique Jamet, une confrontation armée entre le Kremlin et une Ukraine devenue membre de l’OTAN est de nature à dégénérer en troisième guerre mondiale. Les Américains ne peuvent pas ne pas en être conscients. Faut-il alors penser que c’est ce qu’ils recherchent ?
Vladimir Poutine expliquait récemment que la grande faute de l’Occident a été d’avoir obligé l’Ukraine à choisir entre l’Est et l’Ouest, alors que la vocation naturelle de ce pays était plutôt d’établir un « pont » entre eux. Paroles de bon sens ?
Bien entendu, mais il y a bien d’autres frontières qui peuvent servir de « pont » (on aurait pu dire la même chose à propos de l’Alsace-Lorraine, ce qui n’a pas empêché la Première Guerre mondiale d’éclater). En 1823, les États-Unis se sont dotés de la doctrine Monroe, qui interdit toute intervention étrangère dans leur zone d’influence. Le drame de l’Europe est qu’elle n’a pas de doctrine Monroe. Alors qu’elle est fondamentalement complémentaire de la Russie, elle s’inféode chaque jour un peu plus à Washington. Oubliée l’« Europe européenne », il n’y a désormais plus qu’un couple euro-américain sans aucune vision stratégique de ses intérêts, et dont le leadership de Washington constitue le plus petit dénominateur commun. Ne se faisant visiblement plus d’illusions sur les Européens, Poutine, de son côté, se tourne vers la Chine et vers les BRICS. Qui sait que, dans les semaines qui viennent, l’Inde, le Pakistan, l’Iran et la Mongolie vont devenir membres à part entière de l’Organisation de coopération de Shanghai, qui réunit déjà la Russie, la Chine, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le Kirghizistan, soit plus de trois milliards d’habitants ?
En dépit de la propagande médiatique, Poutine conserve en France un indéniable capital de sympathie, tant à droite qu’à gauche d’ailleurs. Êtes-vous de ceux qui voient en lui un « sauveur », dont il faudrait suivre l’exemple ?
Pas plus que je ne suis de ceux qui le jugent avec des formules toutes faites qui ne reflètent jamais que leur ignorance (« nouveau tsar », « ancien kagébiste », « dictateur rouge-brun », etc.), je ne suis un poutinolâtre. Vladimir Poutine n’a certainement pas que des qualités. Sa politique intérieure, ses méthodes de gouvernement peuvent sans doute être critiquées. Il y aussi, chez lui, une sorte d’indécision qui l’empêche de trancher clairement entre les différents clans qui le conseillent. Mais il n’en est pas moins évident que c’est un grand, sinon un très grand chef d’État – l’un des seuls qui existent aujourd’hui. Fort d’un taux de popularité qui excède aujourd’hui 90 %, il a remis la Russie sur ses rails, et aspire à lui rendre le rang qui lui revient. Il veut que cette Russie soit fidèle à son histoire et pense que son peuple mérite d’avoir un destin. C’est déjà énorme. Le simple fait que les États-Unis voient en lui l’obstacle n° 1 à l’instauration du nouvel ordre mondial qu’ils veulent imposer justifie à lui seul qu’on lui apporte un soutien mérité. Car ce contre quoi il se dresse nous menace aussi. Ici et maintenant.
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 24 septembre 2014)